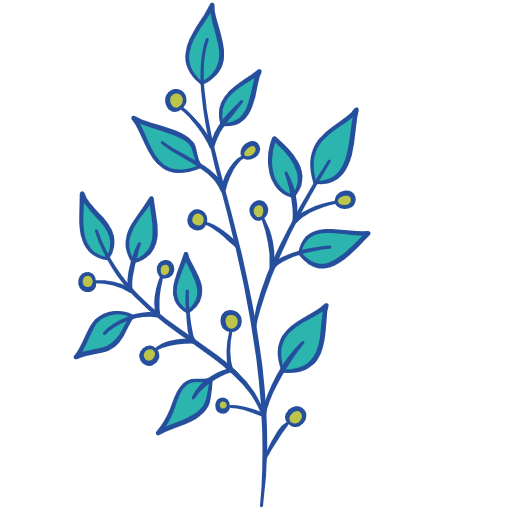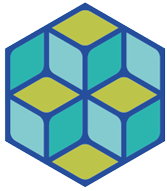Petite enfance
L’analyse de pratique professionnelle, une obligation dans les structures de la petite enfance.
Depuis 2023, j’interviens de plus en plus dans des structures d’accueil de la petite enfance, ce qui me conforte dans l’idée de prendre soin des interactions dès le plus jeune âge.
Dans les structures d’accueil de la petite enfance (crèches, halte-garderies, maisons d’assistantes familiales, …) , les professionnel·le·s exercent un métier avec à la fois une grande charge mentale (organisation), une charge relationnelle et une charge émotionnelle. Qu’il s’agisse de répondre aux besoins fondamentaux des enfants, de soutenir leur développement, d’accompagner les familles ou de travailler en équipe, chaque journée comporte son lot de décisions, d’ajustements et de situations complexes.
Dans ce contexte, l’analyse de la pratique professionnelle constitue un dispositif essentiel au service de la qualité d’accueil et du soutien aux équipes.
Quels sont les objectifs de l’analyse de la pratique ?
Dans un cadre sécurisant et bienveillant, l’analyse des pratiques professionnelles permet de :
-
- déconstruire ce qui pose problème dans la relation d’aide éducative ou soignante ;
- appréhender la complexité des situations afin d’identifier ses possibilités, ses limites, sa place et son positionnement professionnel ;
- prendre du recul sur ce qui se joue singulièrement dans la relation aux enfants et à leurs familles ;
- repérer ses résonances et savoir les utiliser comme ressource dans l’intervention ;
- construire une réflexion groupale permettant les échanges et le partage des ressources et des expériences réciproques ;
- construire des perspectives de solutions respectueuses des besoins des usagers et des possibilités des professionnels

Comment fonctionne l’analyse de la pratique auprès des professionnel·le·s de la petite enfance ?
Mon travail consiste lors de l’analyse de la pratique à garantir un espace de sécurité relationnelle dans lequel les professionnel·les peuvent prendre du recul sur leur quotidien, interroger leurs expériences, partager leurs questionnements et réfléchir collectivement aux dimensions éducatives, relationnelles et organisationnelles de leur travail.
Le cadre de travail est prédéfini au préalable (rythme des séances, 1h30 ou 2h, organisation de la séance, etc…) et l’équipe investit cet espace à sa façon, parfois en travaillant autour d’une situation, parfois autour d’une thématique (ex: le sommeil, la séparation, l’alimentation, etc…). Parfois, j’utilise des outils pour favoriser l’expression et l’élaboration (schémas, carte mentale, jeux de carte expression, etc..) afin que ce temps puisse être dynamisant, notamment lorsqu’il se déroule après une journée de travail. Lorsque cela est utile, je partage des contenus théoriques acquis lors de mes formations. Si l’analyse de la pratique n’est pas un temps de formation, il est un temps de partage de savoirs collectifs.
L’analyse de la pratique se doit d’être un espace ressource pour les équipes pour qu’elles puissent avoir une meilleure compréhension des situations vécues sur le terrain. En mettant en mots les expériences, les difficultés et les réussites, les professionnelles affinent leur lecture des situations, croisent les regards et prennent conscience des enjeux à l’œuvre dans leurs interactions avec les enfants, les familles ou les collègues. Cette élaboration commune favorise la construction d’une posture professionnelle plus ajustée, reposant sur une réflexion partagée.
En valorisant l’écoute mutuelle, la reconnaissance des singularités et la co-construction de sens, l’analyse de la pratique renforce les dynamiques de coopération et la qualité des échanges entre collègues.